Dans Pourquoi les intellectuels se trompent que cette chronique a déjà évoqué la semaine passée, Samuel Fitoussi parle d’un biais de partialité quant à la propension des idéologues à utiliser leurs croyances pour juger d’éléments nouveaux plutôt que de modifier leurs croyances en fonction de ces éléments nouveaux. L’ostracisme dont Simon Leys fit l’objet à la sortie de son livre Les Habits neufs du président Mao de la part des médias supposément bien informés (Le Monde le traita de témoin partiel et partial ; Le Nouvel Observateur, de charlatan…) ne fut pas le seul cas de cécité mentale des intellectuels d’alors.
De Mao à Pol Pot
Hendrik Vuye, professeur de droit constitutionnel et de droits de l’homme à l’Université de Namur, qui, dans un article du 24 août 2024 sur le média flamand Doorbraak, a rappelé que le Grand Bond en avant (1958-60) et la Révolution culturelle (1966-76) ont fait entre 45 et 80 millions de morts selon les sources, rapporte qu’après qu’il eut été de bon ton, notamment dans les cercles intellectuels parisiens (Sartre, de Beauvoir, Barthes, Sollers, Julia Kristeva, etc.) d’idolâtrer Mao, par la suite ce fut un autre paradis rouge qui inspira lesdits cercles, le Cambodge des Khmers rouges. De sa prise du pouvoir en 1975 à 1979, le régime de terreur de Pol Pot fit d’un million et demi à deux millions de morts, soit le quart de la population du pays.
Le jour de l’entrée des Khmers rouges dans la capitale du Cambodge, signale Fitoussi, Libération titrait : « Le drapeau de la résistance flotte sur Phnom Penh ». Ensuite, alors que le génocide était en cours, le même décrivit pendant des mois une société idyllique, des rizières verdoyantes, des rires et des chants de paysans bien nourris. Un professeur belge de l’Université de Louvain, éminent juriste, joua un rôle très en vue, en présidant l’association Belgique-Kampuchéa (le nom du Cambodge de 1975 à 1979) et en étant à la tête de la première délégation occidentale à visiter le « Kampuchéa démocratique » en 1978.
A son retour, il publia un témoignage relayant la propagande des Khmers rouges et passant sous silence leurs crimes. Toute la presse ne resta pas dupe. La Libre publia un article cinglant dans lequel elle plaignait le « pauvre professeur » d’avoir dû se triturer les méninges pour ne pas voir la réalité. Le « pauvre professeur » fut pourtant membre de l’Académie royale de Belgique, juge à la Cour internationale de justice de la Haye et couvert d’honneurs. Il lui aura suffi, commente le professeur Vuye, d’être au bon moment du « bon côté de l’histoire ».
L’intelligentsia souhaitait-elle cacher la réalité du communisme, s’interroge Fitoussi, ou croyait-elle défendre la réalité ? En fait, l’erreur réside dans le fait d’avoir développé des convictions erronées. « Ce qui cause le plus d’ennuis, disait Mark Twain, cité par Fitoussi, n’est pas ce que nous ignorons. C’est ce que nous croyons savoir avec certitude, mais qui n’est pas vrai. » Les idéologues procèdent ainsi : ils jugent tout élément nouveau en fonction de leurs a priori idéologiques et, ce faisant, ils les renforcent. Enfermés dans cette logique, « ceux qui ont tort initialement, s’ils sont rationnels, ont de plus en plus tort ».
Pensée captive
C’est l’explication de l’absence de débat et de la polarisation dans nos sociétés. Dans le déferlement d’infos, chaque camp y trouve matière à raffermir ses positions idéologiques et à projeter ce qu’il croit être la vérité sur ses perceptions. L’idéologie s’auto-alimente. Fitoussi prend comme exemple l’idée que la société puisse être « systémiquement » raciste. Cet a priori inclinera à attribuer chaque déconvenue individuelle d’une personne autre au racisme et nous confortera dans notre préjugé.
En outre, comme nous ne disposons ni d’un temps, ni de ressources cognitives infinis, l’on a en quelque sorte raison d’accepter sans examen les éléments qui vont dans le sens de ce qui nous paraît évident et de balayer d’un revers de la main les objections de nos adversaires, si ce n’est que, relève Fitoussi, si chaque individu adopte cette démarche « rationnelle » (de camper sur ses positions et de se contenter de les défendre), elle aboutit à la faillite collective. Parce qu’il leur en coûte plus de se déjuger qu’au commun des mortels, les intellectuels n’échappent pas à ce travers d’esprit.
Il en est un autre, mis en avant par le prix Nobel de littérature 1980 Czesław Miłosz dans La Pensée captive, son essai sur la place des intellectuels dans les régimes totalitaires, la pensée désidérative, c’est à dire de se représenter le monde non pas comme il est, mais comme nous aimerions qu’il soit. Les croyances, valides ou non, participent de notre bien-être. L’illusion, aussi irrationnelle soit-elle, vaut même parfois mieux que la détresse psychologique causée par la conscience de la réalité. Un intellectuel ne saurait-il jamais trop se méfier des faits susceptibles d’infirmer ses idées fausses ?
L’université n’élude pas les mécanismes de pensée captive. Au contraire, on l’a vu avec le professeur de foi marxiste, cette supposée citadelle de la vérité amplifie le phénomène, surtout dans le domaine des sciences sociales, fort perméable à l’irrationalité. Le problème réside dans ce que les diplômés y sont de plus en plus nombreux et, faute d’autres perspectives professionnelles, représentent une part disproportionnée, par rapport à leur poids dans la population, dans le personnel des mondes institutionnel, politique, culturel et associatif.
En théorie, ce ne devrait pas être un problème que des juristes, des économistes, des philosophes et autres diplômés en sciences sociales s’occupent des affaires publiques ; en pratique, ça l’est, parce qu’ils sont loin de former une élite éclairée et que leurs a priori idéologiques peuvent constituer une menace pour la démocratie.
Pourquoi les intellectuels se trompent, Samuel Fitoussi, 270 p, Editions de l’Observatoire.
Au sujet de l’idéologie, à lire aussi : Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d’idées – L’Europe sous l’emprise de l’idéologie.
* * *
Vous êtes invités à vous abonner gratuitement sur Palingénésie Digest, un regard différent, critique, caustique et sarcastique sur l’état et la marche du monde. Rendez-vous-y et abonnez-vous. (Les deux blogs sont gérés de manière indépendante.)
Le dernier article en date publié sur Palingénésie Digest est à lire via le lien ci-dessous :
Pourquoi le corps académique penche-t-il à gauche ?
Un regard amusant en guise de complément à l’article ci-dessus.
* * *
Soutenez ce site. Achetez, lisez et offrez l’essai Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d’idées – L’Europe sous l’emprise de l’idéologie qui vient de paraître et est disponible, en version papier ou au format kindle, exclusivement sur Amazon.fr en suivant ce lien.
Si vous êtes libraire et souhaitez proposer le livre à vos clients et planifier une causerie sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Palingénésie à l’adresse info@palingenesie.com.
* * *
Aidez Palingénésie à se faire connaître en transférant cet article à vos proches et amis. Merci d’avance pour votre précieux soutien.
En cas de souci quelconque, veuillez envoyer un e-mail à : info@palingenesie.com.
* * *
L’image mise en avant de l’article principal a été générée par l’IA.
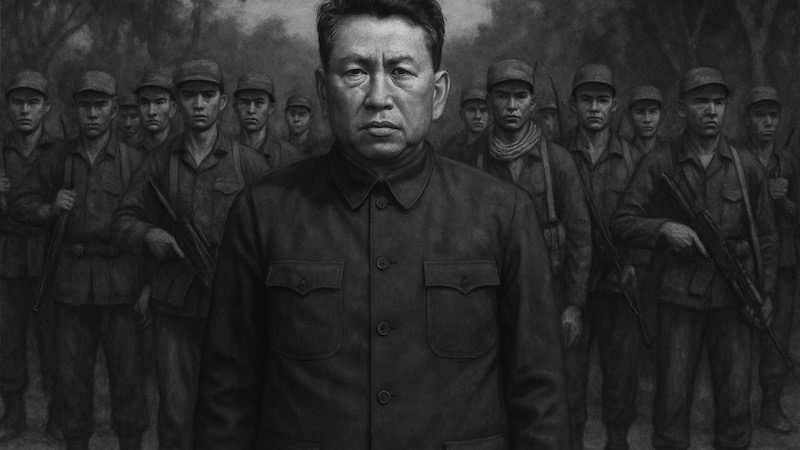
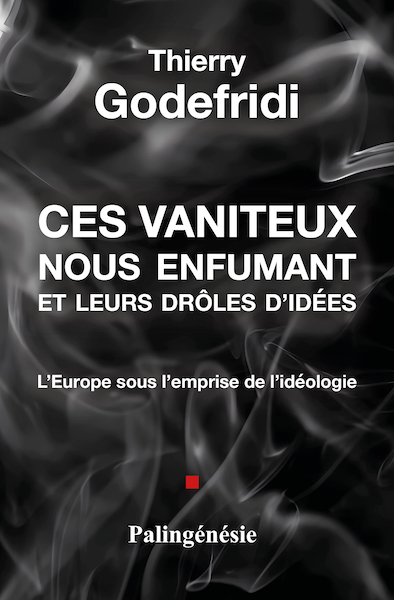
MERCI pour ce texte VRAI et UTILE! J’espère vraiment que les intellectuels se mettent à réfléchir. Trop rares sont ceux qui osent sortir des sentiers battus, des affirmations à la mode…..
Excellent !
Les intellectuels, comme tout un chacun, ont des intérêts à défendre, des carrières à faire avancer, des ego à ménager, des images à soigner. Mais à cela s’ajoute une tentation permanente, celle de Platon : renoncer au monde sensible pour ne plus considérer que le monde intelligible, celui des idées.
L’intellectualisme en est la conséquence inéluctable : une posture marquée par le refus — ou l’incapacité — de regarder le réel tel qu’il est, dans toute sa complexité concrète.
Des intellectuels conservateurs soutenant la politique d’apaisement envers la Russie se sont peut-être également trompés. C’est pourquoi il faut continuer à s’intéresser aux pensées divergentes (de celles auxquelles nous avons fini par adhérer).