En 156, sous l’empereur Titus Antoninus, alors que, se rendant à Alexandrie, il arrivait à proximité d’Oea, ville antique importante de la Tripolitaine (l’Afrique romaine), fondée au VIIe s. avant notre ère par les Phéniciens (aujourd’hui Tripoli), Apuleius eut un accident. Il tomba de sa mule. Secouru par deux pêcheurs, il fut transporté chez la veuve patricienne Pudentilla qui le soigna et l’épousa. Ce mariage ne plut pas au frère de son premier mari dont elle avait eu deux enfants. L’oncle intenta une action en sorcellerie et détournement d’héritage à charge d’Apuleius devant le proconsul d’Afrique, lequel l’innocenta.
En l’an 399 avant notre ère, 557 ans avant le procès à l’encontre d’Apuleius, ce fut Socrate qui fit l’objet d’une plainte, l’accusant de ne pas respecter les dieux de la cité et d’en introduire de nouveaux sous la forme de voix subreptices (daimonia kaina), car il ne se contentait pas de discourir sans fin partout où il déambulait, il prétendait aussi dialoguer avec une voix intérieure mystérieuse par laquelle les hommes se parlent à eux-mêmes, une sorte de « dieu privé » en eux. Socrate refusa de se défendre, sous prétexte que son daimôn le lui avait déconseillé, et fut condamné à boire la cigüe.
Précisons de suite que le démon – intuition profonde ou génie intérieur, l’âme ou la psyché – dont il s’agit ici n’a pas la connotation chrétienne de « démoniaque », ni la signification de ce terme dans Der Kampf mit dem Dämon (Le Combat avec le démon, 1925), l’essai dans lequel Stefan Zweig fit le portrait de trois figures du génie allemand, Kleist, Hölderlin, et Nietzsche. Il est, dans les termes de Pascal Quignard qui a écrit la préface du Démon de Socrate, « cet inconnu qui est en nous plus que nous » : « Tout ce que nous disons, que nous ne sachions le dire ou que nous croyions le dire, est au service de l’inconnu qui fait signe en nous. »
Une puissance « personnelle impersonnelle »
Le mauvais procès dont il fut victime ne manqua pas de rappeler à Apulée (francisation de son nom latin), philosophe lui aussi, celui qui fut intenté plusieurs siècles auparavant à Socrate. Il s’en inspire dans son De deo Socratis (Sur le dieu de Socrate) pour méditer sur le « dieu inconnu », la puissance « personnelle impersonnelle » qui habite en nous, dialectique et démonique, au sens où le CNRTL (le Centre national de ressources textuelles et lexicales) en fait un quasi-synonyme d’irrationnel. Le mot apparaît dans le dernier ouvrage de Bergson, Les Deux Sources de la morale et de la religion, précisément à propos de Socrate : « Un « démon » l’accompagne, qui fait entendre sa voix quand un avertissement est nécessaire. Il croit si bien à ce signe « démonique » qu’il meurt plutôt que de ne pas le suivre ».
« Un démon inconnu me parle. Quelque chose se tient parfois au-dessus de mon épaule. J’entends des voix qui n’ont jamais existé […] », écrit Quignard dans sa préface. « Je ne puis renoncer à ces visitations qui me laissent toujours plus seul et qui m’éloignent toujours davantage des dieux de la cité. » Apulée fut le premier philosophe, commente-t-il, à faire s’équivaloir le « démon » de Socrate et le mot de « conscientia », la conscience que le Larousse définit comme la connaissance, intuitive ou réflexive, que chacun a de son existence et de celle du monde extérieur.
Mais qu’en dit Apulée lui-même ? « La foule des ignorants, étrangère à la philosophie, insensible au sacré, inaccessible à la raison, dénuée de sentiment religieux, incapable de vérité, témoigne par une pratique très pointilleuse, ou un mépris très arrogant, de son peu d’estime pour les dieux – les superstitieux, remplis d’épouvante et les indifférents, bouffis d’orgueil. » Qui sont ces dieux ? « Des êtres incorporels, animés, sans fin ni commencement, existant de toute éternité dans l’avenir comme dans le passé. » « Intellectuellement accessibles à la raison, psychologiquement émotifs », précise-t-il plus loin.
« Quant à leur père, maître et créateur de toutes choses, libre de toutes les entraves du subir et de l’agir et jamais tenu d’exercer une quelconque fonction », Platon lui-même renonça à le décrire, et Apulée à sa suite, car la pauvreté du langage humain les en empêche, encore que des esprits élevés puissent en avoir la perception, par intermittence, dans une sorte de fulgurance, comme la lumière de l’éclair qui transperce la nuit.
L’inconnu qui fait signe en nous
Apulée dans son De deo Socratis rappelle que la philosophie ne se résume pas à des raisonnements abstraits. Elle s’enrichit d’une démarche d’écoute de soi et des autres, de spiritualité et de méditation, dans la recherche de l’inconnu qui fait signe en nous et qui participe de la tradition à laquelle nous appartenons, de l’éducation que nous avons reçue, et de l’expérience de vie que nous avons vécue, de la présence en nous d’une parole qui nous précède. D’où la formule de Quignard : « Cet inconnu qui est en nous plus que nous. » Tout ce que nous disons sert en nous ce qui ne parle pas, le silence intérieur. (Chez Kleist, Hölderlin et Nietzsche, ce génie devient paroxystique ; le démon embrase la pensée au-delà de ce qui est humainement supportable, et, en proie à la quête d’absolu, tue la voix qui le porte.)
Hegel voit dans dans le démon de Socrate non une quelconque superstition antique, mais une figure de la négativité radicale : la voix qui dit non et qui ouvre le domaine de la pensée, laquelle se déploie dans le champ dialectique par la négation (antithèse). La philosophie naît là où l’on accepte de s’arracher à soi. Sans rupture intérieure avec les « dieux de la cité » – le « consensus » comme qui dirait -, sans retrait du monde et retour à soi, il n’y a ni génie, ni dialectique.
Le Démon de Socrate, Apulée, Préface de Pascal Quignard, 110 pages, Rivages poche, Petite Bibliothèque.
* * *
N’hésitez pas à commenter l’article ou à contacter son auteur à info@palingenesie.com. Aidez Palingénésie à se faire connaître en transférant cet article à vos proches et amis. Ils ont le loisir de s’abonner gratuitement à la lettre d’information en cliquant sur ce lien. Merci d’avance pour votre précieux soutien.
* * *
Abonnez-vous aussi (gratuitement) à Palingénésie Digest, un regard différent, critique, caustique et sarcastique sur l’état et la marche du monde. (Les deux blogs sont gérés de manière indépendante.)
Le dernier article en date publié sur Palingénésie Digest est à lire (et éventuellement à commenter) via le lien ci-dessous :
L’Union européenne dans la déni face à son « défi existentiel ».
* * *
Vous pouvez aussi soutenir ce site en achetant ou en offrant Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d’idées – L’Europe sous l’emprise de l’idéologie qui a été repris par The European Scientist parmi les 15 ouvrages à lire absolument pour ne pas céder à l’éco-anxiété et est disponible, en version papier ou au format kindle, exclusivement sur Amazon.fr en suivant ce lien.
Si vous êtes libraire et souhaitez proposer le livre à vos clients et planifier une causerie sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Palingénésie à l’adresse info@palingenesie.com.
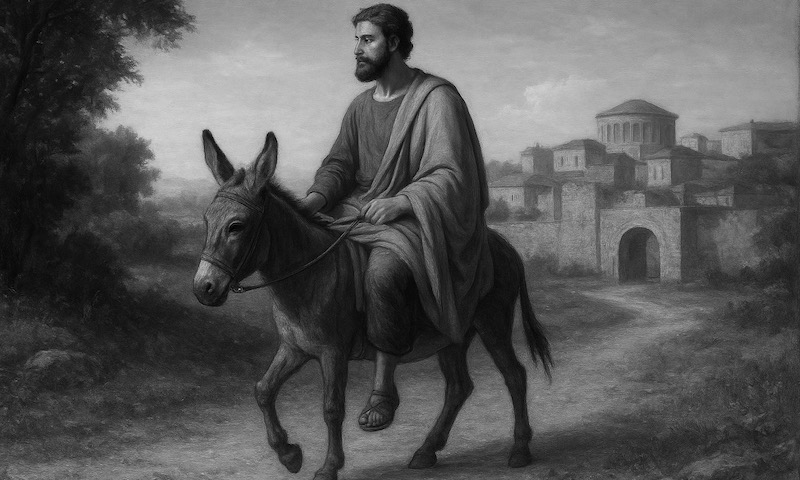
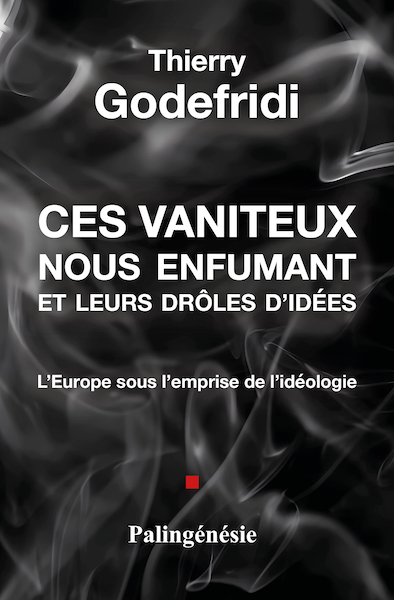
Oui, la philosophie naît là où on accepte de s’arracher à soi!
MERCI pour ce texte intéressant