Un philosophe du cru et d’un fort bon terroir me reprochait récemment un trop-plein d’éclectisme. Il te faut trouver un public, me confia-t-il, et ne pas t’/l’égarer. Il a raison : chaque semaine, certains de ceux qui m’ont rejoint quand j’abordais le thème de l’idéologie politique autour du climat (laquelle fit l’objet de mon livre, Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d’idées, L’Union européenne sous l’emprise de l’idéologie) et en retraçais les racines malthusiennes et eugénistes, certains, donc, me quittent quand j’en aborde un tout autre, l’apport de la pensée girardienne à la compréhension du monde, ou l’éloge de l’erreur et de l’ignorance, ou des sujets plus ésotériques (l’Amérique d’hier et d’aujourd’hui), par exemple.
Il y en a aussi, bien sûr, que le fait de lire que les COP sont un cirque diplomatique qui ne sert à rien insupporte à ce point qu’ils me quittent derechef. Ils se désabonnent des sites sur lesquels je partage mes articles et ils ont bien tort, car tout est dans tout. La réalité est complexe et ne peut être toute entière intégrée en quelques équations. Jean Ladrière, qui était mathématicien et que j’ai eu le privilège d’avoir comme professeur de philosophie de la nature et de philosophie du langage à l’Institut supérieur de philosophie Saint-Thomas d’Aquin de l’Université de Louvain, et moi étions bien d’accord sur ce point.
C’était au temps où vous pouviez soutenir à l’examen de métaphysique qu’elle ne tenait qu’à la foi et que, sans elle, son discours ne valait guère mieux que les spéculations de Freud sur l’inconscient, sans vous faire éjecter d’office. Enfin, cela dépendait bien sûr de l’examinateur. André Léonard, qui fut philosophe avant qu’il ne soit théologien et devint par la suite archevêque et primat de Belgique, se montra plus compréhensif en seconde session de l’examen que le chanoine qui l’avait précédé ne l’avait été en première. L’université ne sacrifiait pas à l’air du temps, la pensée n’avait pas encore été totalement subvertie par l’idéologie.
Le pensable et l’impensable
Toujours est-il que le philosophe dont il est question au début de cet article (et qui publia un livre remarquable d’entretiens avec Mgr Léonard) avait involontairement aussi raison sur cet autre point : peut-être eût-il fallu, au moment de lancer cette chronique il y a quelques années déjà, commencer par se poser la question Qu’est-ce que la philosophie ? Jean-Baptiste Brenet, qui enseigne la philosophie arabe à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, y répond en fin connaisseur d’Aristote et d’Averroès dans un petit livre récent, tiré d’une conférence donnée pour la remise du Prix des Rencontres philosophiques de Monaco, en récompense pour l’ouvrage Que veut dire penser ? Arabes et Latins.
La philosophie, dit Brenet, est une façon de se rapporter intelligiblement au monde, aux autres et à soi, pour comprendre et dire ce que c’est et ce qui se passe, et éventuellement s’y opposer, voire y remédier, autant qu’on le peut. C’est une théorie, une spéculation, à partir de ce que l’on voit. C’est, dit-il, aussi ancien qu’Aristote, lequel fut, des siècles durant, dans les mondes juif, latin et arabe, la référence de la rationalité. Des cinq sens – Aristote parle de chacun -, c’est la vision qui l’emporte. Il s’empresse de faire observer (c’est le cas de le dire) que voir c’est voir le visible évidemment mais aussi l’invisible, son contraire. (Il en va ainsi pour les autres sens – le goût et l’insipide, l’odorat et l’inodore, l’ouïe et l’inaudible -, à l’exception du toucher.)
Cela conduit à assigner à la philosophie la tâche de voir le réel, l’actuel, le positif, et d’apercevoir l’invisible, l’opposé, l’absence. Ce « négatif » comporte plusieurs aspects : la privation (l’obscurité, faute de lumière), l’à peine visible et le trop intensément visible (la lumière aveuglante par rapport à laquelle le face-à-face est intolérable). La philosophie consiste à penser le pensable et l’impensable. Aristote confronte l’intellect à l’immensité – l’infinité – de l’intelligible. En cela, l’intellect est source de puissance : il nous permet de penser ce qui manque, la dimension manquante de la réalité, et d’y pourvoir.
L’homme, animal raisonnable et politique
En d’autres termes, il y a du réel possible, « susceptible d’être ou de ne pas être ». Tout n’est pas joué d’avance, déterminé, fini, pour autant, dit Brenet, se référant au philosophe médiéval persan al-Fârâbî dans son commentaire du traité De l’interprétation d’Aristote, que « je me fie, non pas aux conventions, à la Loi, à la force de l’opinion, de l’Autorité, mais à la potentialité de ma propre nature ». Le monde est le résultat de cette éventualité du possible qui est en nous ; il n’est pas une fatalité qui échapperait à notre vouloir. Cette puissance en chacun de nous ne s’exprime toutefois dans sa plénitude qu’à plusieurs, poursuit Brenet, c’est à dire socialement, politiquement.
Aristote en avait eu plus que l’intuition : l’homme n’est pas seulement un animal doué de raison, il est aussi un animal politique. « L’être humain n’a d’intelligence que politique, au milieu des autres, par eux, dans un ensemble réglé. » Brenet s’inscrit contre la fiction de l’homme seul. Il faut relire, insiste-t-il, un grand chapitre des Politiques d’Aristote où celui-ci défend l’idée de la souveraineté de la masse comme la meilleure forme de gouvernement. Albert le Grand, saint patron des savants et des scientifiques, parle de la puissance de la multitude, moyennant certaines réserves, bien sûr. Encore faut-il que la multitude fasse preuve d’excellence et de prudence et peut-être est-ce plus aisé à réaliser dans le domaine de la connaissance que dans celui de l’agir.
En tout cas, la meilleure forme de gouvernement n’est pas de confier aveuglément le pouvoir à une supposée « élite ». C’est pourquoi l’on ne pourrait adhérer aux conclusions radicales que Dante tire de sa lecture d’Aristote et d’Averroès, à savoir que si nul individu ni groupe (famille, village, cité, nation) ne peut intégrer seul cette puissance qui réside dans l’humanité entière, il reviendrait à une forme d’empire d’agréger l’espèce et d’en accomplir la synergie. Dante eût-il vécu à notre époque, il eût pu constater que l’empire, c’est l’enfer.
Qu’est-ce que la philosophie ?, Jean-Baptiste Brenet, 96 pages, Rivages.
* * *
N’hésitez pas à commenter l’article ou à contacter son auteur à info@palingenesie.com. Aidez Palingénésie à se faire connaître en transférant cet article à vos proches et amis. Ils ont le loisir de s’abonner gratuitement à la lettre d’information en cliquant sur ce lien. Merci d’avance pour votre précieux soutien.
* * *
Abonnez-vous aussi (gratuitement) à Palingénésie Digest, un regard différent, critique, caustique et sarcastique sur l’état et la marche du monde. (Les deux blogs sont gérés de manière indépendante.)
Le dernier article en date publié sur Palingénésie Digest est à lire (et éventuellement à commenter) via le lien ci-dessous :
L’Union européenne dans la déni face à son « défi existentiel ».
* * *
Vous pouvez aussi soutenir ce site en achetant ou en offrant Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d’idées – L’Europe sous l’emprise de l’idéologie qui a été repris par The European Scientist parmi les 15 ouvrages à lire absolument pour ne pas céder à l’éco-anxiété et est disponible, en version papier ou au format kindle, exclusivement sur Amazon.fr en suivant ce lien.
Si vous êtes libraire et souhaitez proposer le livre à vos clients et planifier une causerie sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Palingénésie à l’adresse info@palingenesie.com.
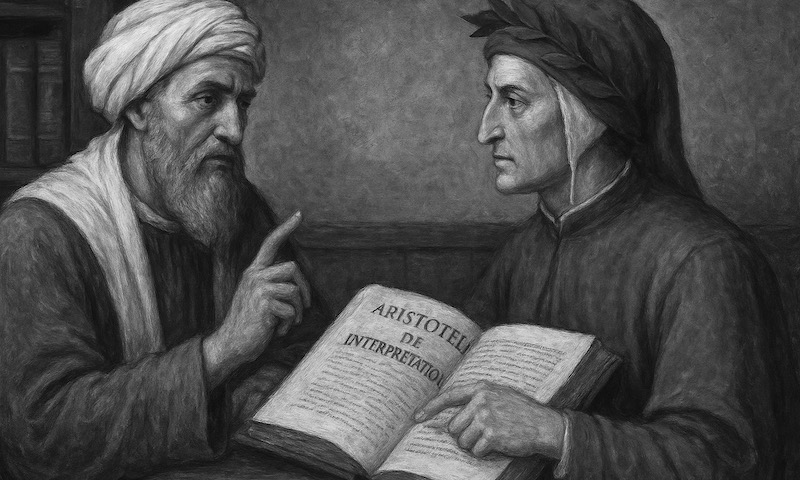
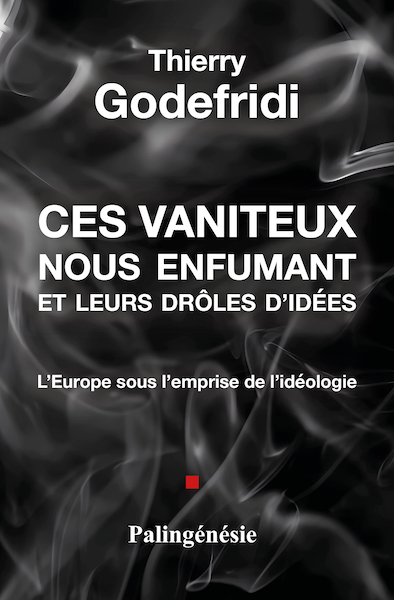
philosopher ? tenter de comprendre le monde pour savoir quoi y faire et pourquoi
Urgence de la philosophie et de son socle inaliénable : voir, mieux (peut-être ?) regarder, le réel, le positif, le factuel. J’adhère ; je ne vois pas comment contester. Et puis ajoutez-vous : penser ce qui manque, le réel possible. Et n’est-ce pas ici et alors que prennent racine toutes les idéologies ? Des plus mortifères à celles qu’on souhaiterait salvatrices ? Comment réguler cette pensée du manque, de l’absence, du « encore rien » ? Par la seule rationalité ? le logos pur ? Urgence d’une épistémologie ? Plus loin dans l’article, je relève, après la réflexion sur le passage de la pensée à l’action (politique) : « il faut que la multitude fasse preuve d’excellence et d’intelligence » Point crucial : se posent ici les questions de l’éducation, de l’instruction, de l’enseignement. Où en sommes-nous en ces domaines ? Je devrais, partant du factuel avant d’envisager le réel possible en ces domaines, poser la question suivante : où en sommes-nous ? Constat final : dans la « babélisation » actuelle, la lumière de l’intellect ouvert sur le réel devient l’ultima ratio.