Philosophe de formation, ayant enseigné aux universités Louis-et-Maximilien de Munich et Paris-I-Panthéon-Sorbonne, Rémi Brague est un homme sérieux. Le titre de son livre publié en 2024 chez Gallimard est à prendre au pied de la lettre. Il ne s’agit pas de rabaisser la morale au niveau du moralisme prégnant qui en est une dérive destinée à culpabiliser, juger, condamner à partir d’une posture de supériorité idéologique, mais, tout au contraire, de l’élever au niveau d’importance et de rigueur qu’elle devrait occuper depuis au moins qu’Aristote y a consacré l’un de ses traités, le plus connu, et de préciser son rôle dans une orientation éthique de l’action humaine.
Ni la morale, ni l’éthique qui ne s’en distingue guère à l’analyse, ne sont destinées par leur nature à servir d’instrument de pouvoir politique. Or, l’histoire montre que des projets prétendument moraux ont servi d’alibi à l’intolérance et à la violence (de l’Inquisition aux puritanismes divers). Le danger subsiste dans nos sociétés qu’une forme de moralisation s’instaure autour d’une cause, quelle qu’en soit la légitimité, qui n’a rien à voir avec la morale : le respect de l’environnement, des minorités et d’autres victimes réelles ou revendiquées, qui tiennent lieu de « classes exploitées », par exemple les animaux ou la Planète (gratifiée d’une majuscule, voire du nom de la déesse Gaïa).
Ces pseudo-morales peuvent même prendre un visage particulièrement pervers quand elles accusent sans laisser de perspective d’absolution des péchés que nous aurions à confesser non parce que nous nous sommes rendus personnellement coupables d’un crime, mais du simple fait que nous sommes ce que nous sommes. Cela autorise tous les égarements. Brague cite Robespierre : « Si le ressort du gouvernement populaire dans la paix est la vertu, le ressort du gouvernement populaire en révolution est à la fois la vertu et la terreur ; la vertu, sans laquelle la terreur est funeste ; la terreur, sans laquelle la vertu est impuissante. La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible ; elle est donc une émanation de la vertu ; elle est moins un principe particulier, qu’une conséquence du principe général de démocratie, appliqué aux plus pressants besoins de la patrie. » Sans doute les Robespierre contemporains escomptent-ils échapper à son funeste sort.
Le moral f… le camp
Faut-il dès lors s’étonner qu’à une époque subvertie par les pseudo-morales, le moral fasse défaut ? Cela ne date pas d’hier, fait remarquer Brague. Oswald Spengler a publié son Déclin de l’Occident il y a un siècle et l’on y constate aujourd’hui un peu partout un même sentiment de désespérance concernant le pays, la culture, la civilisation auxquels on appartient. « Se pourrait-il, s’interroge-t-il, que la baisse du moral soit entraînée, entre autres, par le caractère écrasant, paralysant, que prend une certaine morale ? »
Se pose la question de savoir dans quel domaine la vraie morale a sa place et comment reconnaître les faits qui en relèvent. Brague propose trois éléments distincts mais qui forment système : l’action morale doit concerner autrui, elle doit provenir de moi comme sujet, et elle doit se conformer à une règle. Il s’ensuit dans ce contexte que hisser une réalité autre qu’humaine au rang de personne, voire même en faire l’objet d’une dignité égale (les animaux, par exemple) ou supérieure (la Planète) à notre espèce n’entre pas dans le champ de la morale.
Quant au moi, il a fait l’objet d’une abondante littérature. Brague en extrait une question, celle du Julien Sorel de Stendhal, « Pourquoi suis-je moi ? », et une parabole pour en illustrer la complexité, celle de Kafka, suivant laquelle « la loi ne brille qu’à travers une porte qui est ouverte uniquement pour celui qui s’en enquiert et qui ne s’en rend compte qu’alors qu’il est trop tard ». La littérature existentialiste a fait sien cet aspect de déréliction du sujet abandonné à lui-même. Il n’en reste pas moins, relève Brague, que cela correspond à une composante essentielle de l’expérience morale.
« Oui, sergent instructeur ! »
Cette difficulté de s’enquérir si la porte est ouverte et de s’en rendre compte avant qu’il ne soit trop tard explique, soit dit en passant, le succès des « religions positives » selon le concept de Hegel, en d’autres termes l’attrait des systèmes normatifs rigides imposés de l’extérieur, quels qu’en soient les exigences, les rites et les privations, car, dit Brague, ils ôtent le fardeau de l’angoisse morale. Ai-je bien fait ce qu’il fallait faire ? En adoptant un code, il est facile de se mettre « du bon côté », « en règle ». Il suffit d’obéir et de hurler au bon moment comme Forrest Gump à l’armée : « Oui, sergent instructeur ! » Cela nous éloigne du jugement éthique porté par les stoïciens sur l’action, « qui ne sera droite qui si la volonté était droite car c’est d’elle que procède l’action », et, plus encore, qu’il ne peut en être ainsi que si l’attitude d’esprit dont procède la volonté était droite.
Qui mieux que Kant a défini la règle morale, la vraie, celle qui fait que je n’agis pas n’importe comment et que quiconque devrait pouvoir agir de la même façon à ma place : « Agis de telle sorte que la maxime de ta volonté puisse en tout temps valoir aussi comme le principe d’une législation universelle. » Rien de neuf, à vrai dire, cette règle se rencontre déjà à des époques éloignées et dans des civilisations diverses. Elle a de particulier et d’universel, qu’elle ne suppose pas l’idée de Dieu. Et, elle a en commun avec les préceptes du Décalogue, qu’elle a pour premier souci de préserver l’espèce humaine. Eût-on pu en dire autant jadis des prescriptions du malthusianisme et de l’eugénisme et le peut-on de celles de l’écologie politique et de la visée « décroissantiste » qui la sous-tend ?
Sur la base de ces trois critères, Brague propose trois modèles éthiques : le socio-politique partant de l’idée aristotélicienne que l’homme est un être politique, l’ascétique, pendant du précédent, et le modèle légaliste, propre aux religions révélées mais déjà présent dans le paganisme philosophique qui leur est antérieur. Ces modèles ont une portée uniquement analytique. Les morales concrètes se différencient par le dosage auxquels elles procèdent.
Tout est permis, même d’espérer
Il est un cas éclairant, par contraste, celui de la conscience révolutionnaire, à cheval si l’on peut dire sur le socio-politique qui en devient le critère ultime et sur l’ascétique dans la mesure où elle exige du militant une posture quasi-monastique de pauvreté, d’obéissance et de sacrifice, dans le but de détruire la société telle qu’elle s’est forgée au fil du temps et d’en faire advenir une nouvelle correspondant à l’idéal fantasmé. Tout est permis, si cela sert la cause : le meurtre pour éliminer les opposants, le vol pour s’approprier leurs biens censés avoir été usurpés, le mensonge pour conscientiser les masses. « Nous sommes les premiers au monde, dit le bolchevik lituanien Martin Latsis, qui brandissons le glaive, non pour asservir et opprimer qui que ce soit, mais pour émanciper tous les hommes de l’oppression et de la servitude. » Des Dix Commandements, il ne reste rien. La suite de l’histoire, tout le monde devrait la connaître.
« La liberté [civile], dit Lord Acton, cité par l’auteur, n’est pas un moyen en vue d’une fin politique plus élevée. Elle est elle-même la fin politique la plus élevée ». Le petit livre lumineux et érudit de Rémi Brague contribue à mettre notre époque en perspective, à se défaire des joies tristes et – qui sait ? – à retrouver la joie profonde, communicative et collective, ce « signe précis que notre destination est atteinte » (Bergson), que la vie a pris le dessus.
La morale remise à sa place, Rémi Brague, 160 pages, Gallimard.
* * *
N’hésitez pas à commenter l’article ou à contacter son auteur à info@palingenesie.com. Aidez Palingénésie à se faire connaître en transférant cet article à vos proches et amis. Ils ont le loisir de s’abonner gratuitement à la lettre d’information en cliquant sur ce lien. Merci d’avance pour votre précieux soutien.
* * *
Abonnez-vous aussi (gratuitement) à Palingénésie Digest, un regard différent, critique, caustique et sarcastique sur l’état et la marche du monde. (Les deux blogs sont gérés de manière indépendante.)
Le dernier article en date publié sur Palingénésie Digest est à lire (et éventuellement à commenter) via le lien ci-dessous :
Analyse d’un malaise bien réel.
* * *
Vous pouvez aussi soutenir ce site en achetant ou en offrant Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d’idées – L’Europe sous l’emprise de l’idéologie qui a été repris par The European Scientist parmi les 15 ouvrages à lire absolument pour ne pas céder à l’éco-anxiété et est disponible, en version papier ou au format kindle, exclusivement sur Amazon.fr en suivant ce lien.
Si vous êtes libraire et souhaitez proposer le livre à vos clients et planifier une causerie sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Palingénésie à l’adresse info@palingenesie.com.
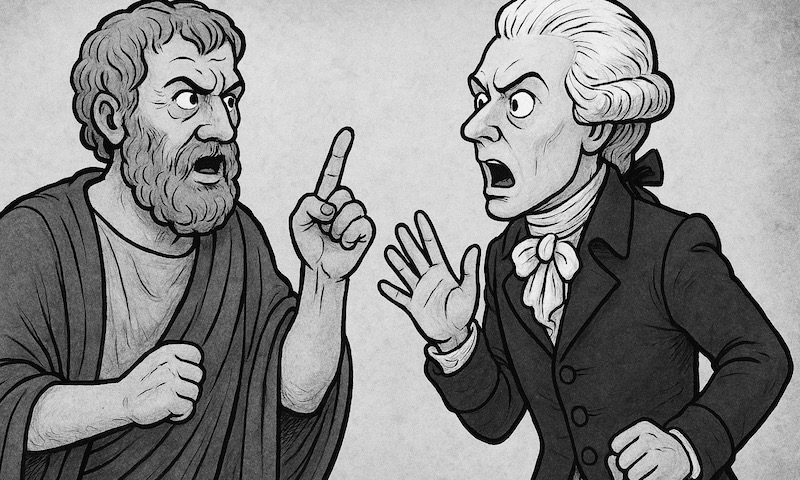
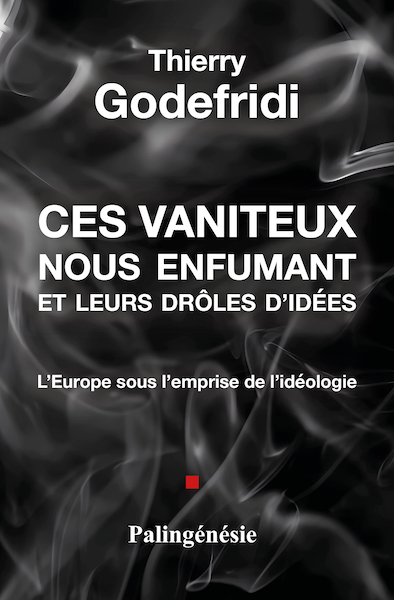
Ces pseudo-morales qui veulent nous apprendre à détester ce que nous sommes!
Il y a de quoi désespérer et nous voyons l’Occident – à la base de toutes les civilisations actuelles – se sentir coupable …. coupable de quoi?
Et on peut tendre vers la VRAIE MORALE qui nous apprend à rendre les autres heureux pour pouvoir être heureux!
Je me suis amusé à colorer mon commentaire de quelques citations savoureuses de Bertold Brecht.
Préface : « Ne serait-il pas plus simple pour le gouvernement de dissoudre le peuple et d’en élire un autre ? » (Bertold Brecht)
Extrait de Wikipedia sur la Règle d’Or : « La Règle d’or est une éthique de réciprocité dont le principe fondamental est énoncé dans presque toutes les grandes religions et cultures : « Traite les autres comme tu voudrais être traité » ou « Ne fais pas aux autres ce que tu ne voudrais pas qu’on te fasse ». Cette forme de morale universelle se retrouve aussi bien dans les préceptes philosophiques de l’Égypte antique et de l’Antiquité grecque que dans les religions orientales (hindouisme, bouddhisme, taoïsme, confucianisme…), proche-orientales ou occidentales (judaïsme, christianisme, islam) ou encore dans l’humanisme athée. La formulation la plus répandue de la Règle d’or en Occident est « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », commandement de la Bible hébraïque (ou Ancien Testament) exprimé dans le Lévitique, développé par Hillel et par les milieux pharisiens puis par Jésus de Nazareth, qui le cite comme étant l’essence des six commandements du Décalogue qui se rapportent aux relations humaines. »
Sauf erreur, Kant s’est légèrement départi de cette règle d’or ou de réciprocité qu’il considérait comme motivée par l’intérêt personnel, préférant la formulation « Fais aux autres ce que tu voudrais qu’ils te fassent ».
Personnellement, je doute que Trump et ses séides, pourtant chrétiens proclamés, aient connaissance de la règle d’or ou même d’Emmanuel Kant. Peut-être devraient-ils se poser la question posée par Bertold Brecht : « Qu’advient-il du trou lorsque le fromage a disparu ? »
De toute façon, à l’exception peut-être du Dalaï Lama, toutes les autorités religieuses ont rapidement enterré cette règle comme un trésor que le commun des mortels ne pouvait pas voir sous peine d’être pétrifié comme tous ceux qui ont croisé le regard de Méduse … Le communisme ne fait évidemment pas exception qui s’est auto-érigé en religion avec ses différentes chapelles ! « En régime communiste, il vous est interdit de vous laisser exploiter : voilà déjà une liberté de supprimée. » (Bertold Brecht)
A propos de Martin Latsis, il « est cité » comme ayant affirmé ce qui suit :
« Nous ne nous battons pas contre des individus isolés. Nous exterminons la bourgeoisie en tant que classe. Ne cherchez pas dans les documents que vous avez rassemblés des preuves qu’un suspect a agi ou parlé contre les autorités soviétiques. La première question que vous devez lui poser est de savoir à quelle classe il appartient, quelle est son origine, son éducation, sa profession. Ces questions devraient déterminer son destin. C’est l’essence de la Terreur rouge. »
Et il a fini comme Robespierre (arrêté le 29.11.1937 par le NKVD et exécuté par balle le 11.2.1938) …
« J’ai connu un docteur, quand il voyait un paysan taper sur ses chevaux, il disait : il recommence à les traiter humainement. Pourquoi ? Bestialement n’aurait pas convenu. » (Bertold Brecht)
La morale ou l’amoral de l’histoire ? Eh oui ! « Il faut chasser la bêtise parce qu’elle rend bête ceux qui la rencontrent. » (Bertold Brecht)
Mais, « vous pouvez retourner ça dans tous les sens, la bouffe vient d’abord, ensuite la morale. » (Bertold Brecht) !
Moralité : « L’homme est bon, mais le veau est meilleur. » (Bertold Brecht)