« Je me suis rendu dans le futur et ça marche ! » Ces propos, tenus par un journaliste à son retour d’avoir accompagné une délégation américaine visiter Lénine en 1919, ont pu paraître prophétiques en 1957 lorsque l’Union soviétique mit sur orbite le premier satellite terrestre, Spoutnik I. L’exploit, suivi à quatre ans d’intervalle par l’envoi dans l’espace du premier cosmonaute, Youri Gagarine, a pu donner à penser que l’URSS avait découvert une recette plus accomplie du progrès. Cette cogitation survenait alors que le débat faisait rage entre partisans de l’école autrichienne d’économie (Ludwig von Mises, Friedrich Hayek…) qui étaient opposés à l’économie planifiée, d’une part, néo-keynésiens et néo-marxistes (Oskar Lange, Abba Lerner…) qui y étaient favorables, d’autre part.
Dans How Progress Ends, Technology, Innovation, and the Fate of Nations, paraissant ce mois-ci aux éditions de la Princeton University aux Etats-Unis, Carl Benedikt Frey rappelle qu’en 1961 Paul Samuelson, un lauréat du Prix Nobel et l’un des économistes les plus fameux de son temps, prédit que le revenu national de l’URSS pourrait surpasser celui des Etats-Unis dès 1984, mais plus probablement en 1997. Le développement par tâtonnements au hasard des caprices du marché était passé de mode. Non seulement l’Union soviétique était supposée dépasser les Etats-Unis sur le plan technologique, mais cet avantage semblait confirmer la supériorité du planisme économique.
Ces délibérations resurgissent avec l’avènement de l’intelligence artificielle. Jack Ma lui-même, le génial fondateur d’Alibaba, aurait suggéré que l’IA élèverait notre perception du monde à un niveau supérieur et nous permettrait finalement de planifier l’économie. Ayant retenu la leçon de ne point trop en dire, il s’est abstenu d’ajouter que l’IA permettrait aussi au Parti communiste de renforcer son contrôle sur la société chinoise et sa mainmise sur le pouvoir. Un étudiant aurait demandé à l’auteur si la Chine pourrait enfin réaliser le rêve soviétique d’une domination technologique autoritaire. Le traité de ce professeur associé spécialiste de l’IA à l’Oxford University, vise à répondre à la question et en soulève d’autres, car lui aussi, s’appuyant sur mille ans d’histoire du progrès, se projette dans le futur pour voir ce qui marche.
Le pire n’est jamais certain
Quoique l’on dise que « le propre des apothéoses est de déboucher sur le déclin », ce dernier n’est nullement inévitable. L’Amérique a déjà fait preuve d’un talent sans pareil pour s’adapter à l’évolution technologique. (Il n’est pas anodin à cet égard que l’administration Biden ait tenté de revitaliser les dispositions antitrust aux Etats-Unis : elles conditionnent l’innovation.) La Chine de M. Xi, aussi improbable cela puisse-t-il paraître, pourrait s’inspirer de l’exemple de Taiwan, sa « province renégate » qui a démontré avec succès que la décentralisation économique et politique est faisable et avantageuse. Cependant, l’une et l’autre économie, l’américaine et la chinoise, semblent vouées à la stagnation. Si tel s’avère le cas, l’Europe en souffrira économiquement plus qu’elle ne souffre déjà de ses propres inepties. En effet, fait observer Frey, elle dépend largement de l’apport technologique des Etats-Unis et de la Chine et du commerce avec eux.
En outre, la propension européenne à légiférer à tout va (à commencer par le RGPD et bientôt l’IA Act), censée protéger ses industries contre la concurrence extérieure, constitue un obstacle infranchissable pour nombre de ses propres petites et moyennes entreprises, le tissu le plus dynamique et adaptatif de l’économie, et favorise la concentration entre grands acteurs, seuls à disposer des ressources pour se conformer aux réglementations multiples et diverses. Le FMI estime que les barrières internes à l’Union européenne ont le même effet que l’auraient des droits de douane à l’entrée de 45% sur les produits manufacturés et de 110% sur les services. Puisse le message passer dans les hautes sphères de la bureaucratie européenne, mais doutons que les idéologues qui les hantent ne le reçoivent.
La comparaison, documentée par Frey, avec la Chine médiévale est de ce point de vue fort parlante. Quand la technologie sert le pouvoir investi, les prélèvements obligatoires et la guerre (suivez ce regard belliqueux de sainte nitouche drapée aux couleurs de l’Ukraine), l’esprit républicain s’éclipse, l’empire s’emballe. Ce n’est pas que le « progrès » ne puisse être piloté « d’en haut ». Il y eut des cas : Frey cite le « projet Manhattan » (le projet de recherche du gouvernement américain de construire la bombe atomique pendant la Seconde guerre mondiale) et, récemment, les vaccins à ARN messager. Les avis sont partagés quant à l’opportunité de ces développements.
Le pouvoir et ses prébendiers
Reste à se demander pourquoi l’ensemble des pays du monde ne se sont pas développés de la même manière, d’autant plus que les « derniers arrivants » ont l’avantage de disposer des développements mis au point par leurs prédécesseurs et de les adopter ou adapter sans devoir « réinventer la roue ». La question a longtemps suscité la perplexité parmi les économistes. Les raisons des divergences de niveau de développement sont multiples : un manque de compétences administratives ou politiques, les failles du système d’éducation générale, une volonté de préserver le statu quo et ses rentes : que ne feraient ceux qui en sont investis pour conserver le pouvoir ?
Frey compare à ce sujet les situations en Angleterre, en Allemagne et en Russie au XIXe siècle. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Il suffit souvent d’un ingrédient (ou d’un grain de sable) pour alimenter (ou enrayer) la machinerie du progrès. Ce n’est pas une coïncidence s’il fut un temps – celui de Mme Thatcher – pendant lequel le Royaume-Uni surpassa l’Allemagne et la France, ni si, un siècle plus tôt (à la fin du XIXe), les Etats-Unis entamèrent leur prodigieux essor économique sous la direction d’un gouvernement fédéral à taille humaine. Honni soit qui mal y pense. Qu’elle vous serve de boussole géopolitique ou de guide pour vos investissements, cette somme de 552 pages mérite le voyage dans le temps (passé, présent, futur) auquel son auteur vous convie.
How Progress Ends, Technology, Innovation, and The Fate of Nations, Carl Benedikt Frey, 552 p, Princeton University Press.
* * *
Aidez Palingénésie à se faire connaître en transférant cet article à vos proches et amis. Ils ont le loisir de s’abonner gratuitement à la lettre d’information en cliquant sur ce lien. Merci d’avance pour votre précieux soutien.
* * *
Abonnez-vous aussi (gratuitement) à Palingénésie Digest, un regard différent, critique, caustique et sarcastique sur l’état et la marche du monde. (Les deux blogs sont gérés de manière indépendante.)
Le dernier article en date publié sur Palingénésie Digest est à lire (et éventuellement à commenter) via le lien ci-dessous :
Les Etats-Unis jouent-ils avec le feu ?
Où il est question d’un sujet qui n’intéresse pas grand monde. Et pourtant…
* * *
Vous pouvez aussi soutenir ce site en achetant ou en offrant Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d’idées – L’Europe sous l’emprise de l’idéologie qui a été repris par The European Scientist parmi les 15 ouvrages à lire absolument pour ne pas céder à l’éco-anxiété et est disponible, en version papier ou au format kindle, exclusivement sur Amazon.fr en suivant ce lien.
Si vous êtes libraire et souhaitez proposer le livre à vos clients et planifier une causerie sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Palingénésie à l’adresse info@palingenesie.com.

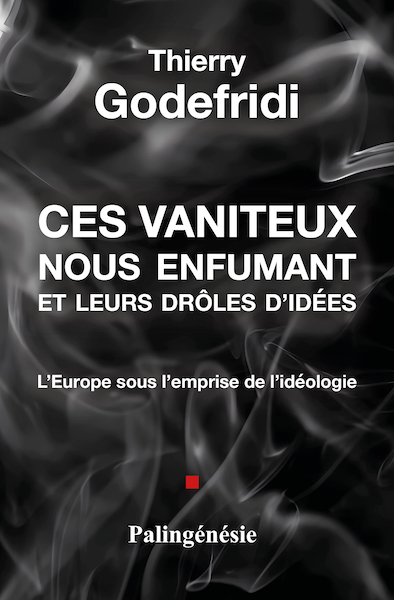
MERCI pour ce texte intéressant et utile!