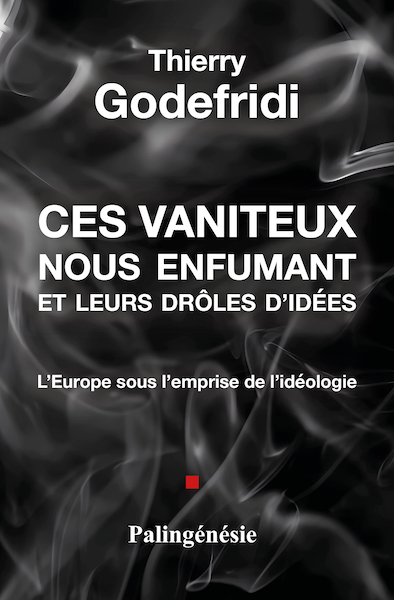Le concept a été inventé par Horace Walpole au XVIIIe et fait référence au conte des Trois Princes de Serendip. Le Robert définit la sérendipité comme une « capacité, aptitude à faire par hasard une découverte inattendue et à en saisir l’utilité (scientifique, pratique) ». Par hasard ? Cleevely soutient avec conviction et expérience à l’appui que nous pouvons lui donner un sérieux coup de pouce. Disons-le d’emblée, Serendipity, de David Cleevely, est à lire toutes affaires cessantes, d’abord parce qu’il est plaisant à lire (ce qui facilite les choses pour le public francophone, car il n’a pas encore été traduit), ensuite et surtout parce qu’il répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser. La sérendipité trouve des applications pratiques dans tous les domaines de l’existence.
Vivre, c’est agir
Quatre conditions conditionnent les découvertes fortuites. Premièrement, il doit exister des réseaux, dit-il, des maillages riches et dynamiques qui favorisent la libre circulation des personnes, des idées et des ressources. Deuxièmement, la diversité est essentielle pour générer de nouvelles perspectives remettant continuellement en question les hypothèses existantes. Troisièmement, il doit y avoir un esprit d’ouverture afin d’intégrer l’inattendu et le changement. Enfin, la sérendipité nécessite que les esprits, les individus et les organisations, soient préparés, non seulement capables de repérer une opportunité lorsqu’elle se présente, mais aussi d’agir efficacement pour la saisir. Agir ! Vivre, c’est agir, dit Anatole France. Le mot revient tout au long de l’ouvrage de Cleevely.
Son argument central est le suivant : le hasard n’est pas fortuit. Il suit des schémas prévisibles. Il est conditionné par la configuration de nos réseaux, la manière dont l’information se diffuse et les structures qui régissent les rencontres fortuites. Si certaines personnes, organisations et villes enregistrent plus d’avancées que d’autres, ce n’est pas par hasard, dit-il, mais parce qu’elles sont mieux connectées, ce qui amplifie la probabilité de coïncidences heureuses. En fait, il y a des mécanismes sous-jacents à l’oeuvre, que la science explique : la théorie des réseaux, la probabilité, la science de la complexité, des domaines rigoureux qui permettent de comprendre de manière systématique pourquoi le hasard n’est ni un accident, ni une illusion – c’est une bonne nouvelle, non ? – et comment la sérendipité se produit en fonction des connexions et de la circulation de l’information.
Comment les réseaux façonnent nos vies
Un élément critique de l’efficacité d’un réseau paraît être que vous ne soyez pas éloigné de plus de trois degrés du décideur ou de la personne dont vous avez besoin. Deux chercheurs, l’un professeur à Harvard et l’autre à l’université de Californie à San Diego, Nicholas Christakis and James Fowler, connus pour leurs travaux sur les réseaux sociaux et la contagion sociale, popularisés dans leur livre Connected : The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives, ont démontré que les réseaux influencent les comportements liés à différents aspects de la vie (santé, émotions, mobilisation politique, etc.) jusqu’à trois degrés de séparation et qu’ensuite leur influence s’atténue considérablement.
Il n’est pas inintéressant à ce sujet de savoir qu’une étude, datant de 2011-2012 et analysant à grande échelle les utilisateurs actifs de Facebook à l’époque, a révélé que deux membres quelconques de la communauté n’étaient séparés que de 3,74 degrés. Elle a ainsi montré que le monde était devenu un village. Reste la question de savoir s’il est possible de concevoir des réseaux optimisés pour générer de la sérendipité ? Il est aisé d’imaginer la réponse d’un point de vue géométrique : il ne suffit pas que les habitants d’un village forment un cercle en se donnant la main pour qu’une information circule rapidement d’une personne à l’autre. Il faut que des sécantes (porteuses de flux d’informations) traversent le cercle (fussent-elles des weak ties, c.-à-d. des connexions superficielles) afin de réduire la distance séparant deux quelconques de ses membres et de se rapprocher du degré de séparation magique de 3 mentionné plus haut.
La sérendipité en pratique
L’art de la sérendipité réside dans la mise en pratique de cette vision. Il faut déjà noter que ceux des opérateurs de réseaux sociaux qui créent des chambres d’écho s’écartent des conditions premières de la sérendipité, puisque celle-ci « se nourrit » précisément – on l’a vu – de diversité et d’ouverture. En d’autres termes, ne vous fiez pas aux vertus de la virtualité – ses mobiles ne sont pas nécessairement de rendre service mais de servir et d’abord à ceux qui en ont fait leur métier. Cleevely parle en toute connaissance de cause : il a participé à la mise en oeuvre de réseaux de sérendipité à l’université de Cambridge. Leur succès lui en fait parler comme d’un laboratoire vivant pour observer les principes des réseaux en pratique et le potentiel des concepts théoriques qu’il expose – liens faibles, réseaux à monde petit, règle des trois degrés, redondance. Ils se manifestent tous, témoigne-t-il, de manière concrète, à travers les interactions quotidiennes sur le campus et dans la ville de Cambridge.
On l’aura compris, la chance ne surgit pas de nulle part, inexplicablement. Encore faut-il être prêt à la remarquer et la saisir. Ce n’est pas simplement une question d’être au bon endroit au bon moment, ni même d’être intelligent, c’est une façon d’être, de penser et, surtout, d’agir. Audentes fortuna iuvat, dit le proverbe : la chance sourit aux audacieux.
Serendipity, It doesn’t happen by accident, David Cleevely, C&P, 336 pages.
* * *
N’hésitez pas à commenter l’article ou à contacter son auteur à info@palingenesie.com. Aidez Palingénésie à se faire connaître en transférant cet article à vos proches et amis. Ils ont le loisir de s’abonner gratuitement à la lettre d’information en cliquant sur ce lien. Merci d’avance pour votre précieux soutien.
* * *
Abonnez-vous aussi (gratuitement) à Palingénésie Digest, un regard différent, critique, caustique et sarcastique sur l’état et la marche du monde. (Les deux blogs sont gérés de manière indépendante.)
Le dernier article en date publié sur Palingénésie Digest est à lire (et éventuellement à commenter) via le lien ci-dessous :
Une réflexion sur les interprétations du concept au XXIe siècle.
* * *
Vous pouvez aussi soutenir ce site en achetant ou en offrant Ces vaniteux nous enfumant et leurs drôles d’idées – L’Europe sous l’emprise de l’idéologie qui a été repris par The European Scientist parmi les 15 ouvrages à lire absolument pour ne pas céder à l’éco-anxiété et est disponible, en version papier ou au format kindle, exclusivement sur Amazon.fr en suivant ce lien.
Si vous êtes libraire et souhaitez proposer le livre à vos clients et planifier une causerie sur le sujet, n’hésitez pas à contacter Palingénésie à l’adresse info@palingenesie.com.